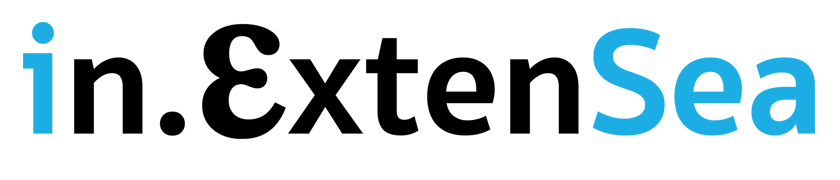Le naufrage de l’Erika : retour sur une catastrophe écologique
« Il n’y avait plus de mer, c’était une mer de pétrole épais ». Ces mots, prononcés fin 1999 à l’occasion du naufrage de l’Erika, témoignent de l’ampleur de la pollution qui s’en est suivie. L’Erika fait partie de la longue liste des navires qui, depuis cinquante ans, ont pollué les côtes bretonnes : le Torrey Canyon en 1967 ; l’Olympic Bravery et le Boelen en 1976 ou encore l’Amoco Cadiz en 1978, le Tanio en 1980 ou le Thisseas en 2016.
Le 12 décembre 1999, dans la zone économique exclusive française (ZEE), le naufrage du pétrolier Erika est à l’origine de la pollution de près de 400 km de côtes, marquant durablement l’opinion publique et déclenchant un procès de grande ampleur. Plusieurs dizaines de collectivités territoriales, associations et particuliers portent plainte contre les opérateurs maritimes impliqués : le propriétaire du navire, l’affréteur, le gestionnaire technique et nautique, la société de classification, encore le propriétaire de la cargaison.
Au-delà de la brutalité des faits, l’affaire Erika constitue un tournant décisif dans la lutte contre les les marées noires. Comme toutes les affaires en droit maritime, l’affaire Erika est complexe, ce qui n’empêchera pas les juridictions françaises de rendre des décisions aussi longues que retentissantes. Avant que la cour de cassation ne mette fin à l’affaire le 25 septembre 2012, les juges du fond admettront la compétence des juridictions françaises pour connaitre du dommage de pollution par hydrocarbures intervenu dans la ZEE de la France ; ils recevront encore les constitutions de partie civile des collectivités territoriales, de même que la responsabilité pénale du propriétaire de la cargaison pour infraction de pollution involontaire (par faute d’imprudence) et – surtout – l’existence autonome du préjudice écologique.
Pour admettre la compétence des juridictions françaises et l’application du droit national par préférence à la convention CLC, la cour va s’appuyer sur le caractère particulièrement grave de la pollution dont les conséquences se sont étendues à la mer territoriale mais encore par les dispositions de l’article 211 de La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) qui permettent à l’État côtier de légiférer en la matière.
Sur le plan pénal, la Cour retient que le processus de ruine de l’Erika est la conséquence d’une corrosion en relation directe avec l’entretien insuffisant du navire. Dès lors, pour caractériser le délit de pollution marine par imprudence, les juges vont analyser les fautes commises par l’ensemble des opérateurs exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche de l’Erika. C’est ainsi que l’affréteur au voyage se voit imputer une faute d’imprudence commise lors du vetting (i.e. l’inspection interne du navire affrété, précaution prise pour déterminer les risques que celui-ci peut présenter pour la compagnie). L’armateur est condamné pour avoir volontairement minimisé l’entretien dans des proportions telles qu’il ne pouvait ignorer que cela mettait en jeu la sécurité du navire. Il est reproché à la société gestionnaire du navire, outre d’avoir pris la décision de procéder à des réparations a minima, de n’avoir pas averti l’État côtier et de n’avoir pris aucune mesure pour combattre ou limiter les effets de la pollution. Les juges ont encore estimé que la société de classification disposait d’un pouvoir de contrôle sur la gestion de l’Erika et que la confirmation, en 1999, du certificat de classe du navire était fautive.
Sur le plan civil, des condamnations sont prononcées contre le propriétaire du navire, son gestionnaire, son affréteur de fait, enfin contre la société de classification. Alors que les règles classiques de la responsabilité civile distinguent entre les préjudices matériel, corporels et moraux, l’affaire Erika distingue entre les préjudices subjectifs (patrimoniaux et extrapatrimoniaux) et le préjudice écologique.
Au titre des préjudices patrimoniaux réparables, la Cour vise d’abord le préjudice matériel lié aux activités de dépollution ; elle vise ensuite le préjudice économique résultant de la pollution, constitué par l’ensemble des pertes et revenus et des gains manqués. Mais c’est la consécration du préjudice écologique qui est l’apport le plus visible de l’affaire Erika. Intégré au Code civil français par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le préjudice écologique contribue à l’extension des catégories de préjudices réparables, qui comprennent désormais un préjudice spécifique n’affectant aucune personne isolément mais la collectivité des hommes qui vivent en interaction avec l’intérêt endommagé.
Désormais, il existe un chef de préjudice autonome pour les dommages causés à l’environnement, dont le législateur, par un subtil mélange des principes du droit de l’environnement et de ceux du droit de la responsabilité civile, a prévu les modalités de réparation. Il s’agit là d’une avancée majeure dans la lutte du droit contre les pollutions marines. Au-delà de l’affaire Erika, la tendance est aujourd’hui à la responsabilisation de l’ensemble des acteurs maritimes. Les enjeux environnementaux prennent de plus en plus d’ampleur dans les débats sur les activités qui sont menées en mer, comme en témoignent les nouvelles limites fixées par l’OMI quant à la teneur en soufre du fuel-oil utilisé par les navires à partir du 1er janvier 2020.
L’affaire Erika a permis de mettre en lumière les insuffisances du droit international pour les dommages graves. Dans ces situations, la limitation de responsabilité altère la réparation du préjudice et fait apparaitre la nécessité d’adapter les droits nationaux pour tendre à la réparation intégrale des dommages concédés. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains États comme le Sénégal ont exclu, sans aller toutefois aussi loin que le législateur français, la possibilité pour le propriétaire du navire d’opposer la limitation de responsabilité aux créances nées des dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures (C. mar. march., art. 115, issu de la Loi n° 2002-22 du 16 août 2002). Gageons que le futur Code de la marine marchande apportera des éléments nouveaux susceptibles de renforcer le dispositif en tirant profit, peut-être, des solutions mises en œuvre dans l’affaire Erika. En tout état de cause, cette affaire constitue un tournant décisif dans le droit des pollutions marines. Comme ont pu l’affirmer nombre d’auteurs, il y a bien, en matière de sécurité maritime en général et de lutte contre les pollutions marines en particulier, un avant et un après Erika.
Photo : impression écran Youtube